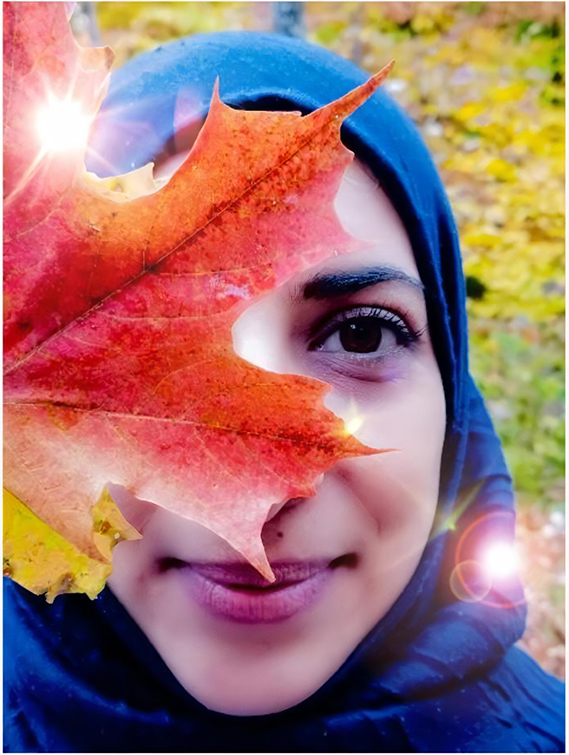Amal AbdulQader
![]() Reading Time: 13 minutes
Reading Time: 13 minutes
AGENT DE LIAISON MULTICULTUREL
Amal a hésité avant d’accepter une entrevue pour notre galerie de portraits de diplômés. « Je n’étais pas certaine que mon profil s’y prêtait parce que mon histoire est confuse, avec des hauts, mais aussi beaucoup de bas. » Elle a changé d’avis quand elle a réalisé qu’elle pourrait ainsi revenir sur son odyssée et retracer son parcours. L’itinéraire d’Amal l’a menée du Yémen à la Malaisie, aux États-Unis puis au Canada, où elle travaille actuellement pour un centre de services aux immigrants à leur arrivée dans le pays. Élevée dans un Yémen conservateur où les filles étaient destinées au mariage précoce pour devenir femmes au foyer, Amal a une carrière admirable. C’est la volonté de faire une différence qui la motive depuis qu’elle est jeune.
Contre toute attente et bravant les objections de plusieurs membres de sa famille, Amal a suivi une formation universitaire grâce à des bourses prestigieuses accordées aux étudiants « à fort potentiel » et en est ressortie avec deux mastères. Dans le contexte d’un pays déchiré par la guerre, elle a suivi un programme MBA à Audencia avant de retourner dans son pays pour jouer un rôle prépondérant dans le processus de transition politique (interrompu par la suite), puis d’être recrutée par les Nations Unies. Le témoignage d’Amal atteste de sa force de caractère. On a l’habitude des histoires dont le héros altruiste est récompensé à la fin. Mais Amal a fini en exil et ces dernières années ont été teintées d’amertume.
La vie d’Amal, comme celle de millions de migrants, dépasse la fiction. Nous sommes profondément reconnaissants à Amal de nous avoir accordé cette entrevue.
Quelles sont vos origines familiales ?
Je suis l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. Je suis née et j’ai grandi au Yémen. Mes deux parents étaient instruits et avaient une grande ouverture d’esprit, ce qui fait figure d’exception dans un pays aussi pauvre et traditionaliste. Ma mère rêvait de devenir femme d’affaires ou économiste. Elle a épousé mon père – alors étudiant, mais qui est ensuite devenu directeur général dans le secteur financier – quand elle était encore au lycée. Dans ces années-là, il était inhabituel que les femmes suivent des études supérieures, mais mon père l’a encouragée et elle a obtenu un diplôme en économie et en sciences politiques de la Faculté des affaires et du commerce. Ma mère était déterminée à travailler, ne serait-ce que comme enseignante, et pas uniquement parce qu’elle accordait de l’importance à l’estime de soi et à l’indépendance, mais également parce qu’elle voulait se joindre aux efforts de mon père pour nous offrir une qualité de vie, ce qui supposait d’être éduqué dans le système privé.
Quel genre d’enfant étiez-vous ?
Nous vivions avec ma famille élargie et j’entends encore les rires résonner dans l’enceinte de notre maison. J’étais l’aînée de 13 cousins et cousines, et je suis devenue la cheffe du groupe tout naturellement. Mon grand-père et mon père m’adoraient et ils étaient fiers de ma maturité. Quand j’ai eu neuf ans, ils ont commencé à me confier leurs préoccupations et à m’impliquer dans les décisions familiales. De mon enfance, j’ai le souvenir d’une impression de liberté et d’innocence, et d’un sentiment de fierté du fait de contribuer aux affaires familiales importantes. Je suis reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de prendre confiance en moi et d’avoir eu des responsabilités, car cela m’a aidée à me préparer aux difficultés qui m’attendaient. J’avais 27 ans quand mon père est mort et j’ai naturellement pris le relais pour aider ma famille financièrement et psychologiquement.
L’adolescence est une transition importante pour les filles au Yémen, car elles sont alors séparées des garçons. Comment avez-vous vécu cette période ?
Nous étions en classes mixtes, l’école était amusante et j’étais une enfant joyeuse et loquace. Mes parents étant ouverts d’esprit, j’avais le privilège d’être autorisée à jouer avec les garçons après l’école. Mais quand j’ai eu douze ans, on m’a fait prendre conscience des transformations de mon corps et soudainement, j’ai été considérée comme une femme. La société attendait de nous que nous nous « comportions comme des dames », ce qui impliquait de porter le hijab, d’éviter de parler fort ou de rire de manière démonstrative, et de se voir attribuer un « tuteur masculin », qui prenait des décisions à notre place. J’étais préparée à ce rite de passage, mais malgré tout, j’ai vécu cette atteinte à mon mode de vie et à ma liberté comme une cruelle injustice.
Vous vouliez devenir médecin… n’est-ce pas un rêve de garçon au Yémen ?
Depuis que je suis toute petite, on me surnomme « Docteur Amal ». J’ai toujours eu de bons résultats scolaires et au Yémen, la voie royale pour les bons étudiants, c’est de faire des études d’ingénieur ou de médecine. Je voulais devenir médecin, car je pensais que ce serait le meilleur moyen d’aider les personnes vulnérables… Et c’est aussi parce que mon côté rebelle voulait désespérément prouver à tout le monde, y compris à moi-même, que je pouvais réussir dans un domaine traditionnellement réservé aux hommes !
Ma manière de gérer la façon dont on me traitait en tant qu’adolescente a été de me replier sur moi-même et de me concentrer exclusivement sur mon éducation. Je suis devenue une personne calme, introvertie, solitaire… mais ç’a porté ses fruits.
Quand j’ai eu fini le lycée, mes parents ont reçu de nombreuses demandes en mariage. L’âge d’or pour se marier, c’est à 17 ou 18 ans, pour obtenir une protection et la sécurité économique. Ma mère a appuyé ma décision d’aller à l’université auparavant, s’opposant ainsi aux objections d’une partie de ma famille. Ma vie aurait pu prendre un tout autre tournant sans ma mère, mon père et mon grand-père, qui ont compris et respecté mes décisions.
J’ai travaillé extrêmement dur pour réussir l’examen d’entrée à l’école de médecine. Mes parents étaient tellement fiers quand j’ai été reçue. Je me suis spécialisée en pharmaceutique. Ma vie sociale était pauvre, parce que j’étais obsédée par la réussite académique et je suis devenue compétitive. J’ai caché ma féminité parce que j’étais mal à l’aise quand on me complimentait sur mon apparence ; je voulais qu’on me remarque pour mon intelligence.
Après avoir obtenu votre diplôme de pharmacienne, vous avez pris la décision courageuse d’orienter votre carrière dans une direction diamétralement opposée. Quel a été l’élément déclencheur ?
En troisième année à l’université, j’ai participé à une conférence pour la jeunesse axée sur le développement, organisée par un organisme de collaboration entre le Canada et le Yémen afin de donner aux jeunes les moyens de se fixer des objectifs, de renforcer leur confiance en soi et de se constituer des réseaux. Le fait de rencontrer des intervenants et des activistes fascinants, et d’échanger pour la première fois avec des personnes venues de l’étranger a opéré un changement de personnalité en moi. L’intello que j’avais été pendant des années a eu un éclair de lucidité : je pouvais être une étudiante sérieuse tout en me connectant à mon entourage. La personnalité joyeuse et extravertie que j’avais été enfant a refait surface et je suis sortie de ma coquille. J’ai commencé à faire du bénévolat pour plusieurs ONG et à m’investir dans la communauté.
Quelques années plus tard, j’ai réalisé que je n’étais pas faite pour travailler dans le secteur pharmaceutique. Je voulais travailler dans un laboratoire pour inventer de nouveaux traitements afin d’améliorer la vie des populations, mais au lieu de cela, j’avais atterri dans la vente, une fonction dans laquelle mes clients peinaient à me prendre au sérieux à cette période, parce que j’étais une femme. Surtout, je n’avais pas le sentiment d’apporter quoi que ce soit. Je me suis faite à l’idée que ce n’est pas parce que j’avais étudié dur pendant cinq ans que je devais rester coincée dans ce secteur jusqu’à la fin de ma vie.
Il n’a pas été facile d’annoncer à mes parents que je me tournais vers des activités à but non lucratif, mais ils ont fait confiance à ma décision. J’ai commencé à coordonner des programmes pour la santé, l’éducation et les droits humains, et j’ai rapidement été promue cheffe de projet : j’avais trouvé ma vocation.

Pourquoi avez-vous décidé de venir étudier à Audencia ?
À 30 ans, après cinq ans sur le terrain, j’ai décidé qu’il était temps d’essayer de concrétiser mon rêve d’aller étudier à l’étranger et de découvrir le monde (j’avais candidaté en secret pour que personne ne puisse me retenir). Une poignée seulement de bourses prestigieuses étaient accessibles pour les étudiants yéménites, dont une pour un MBA à Audencia, financé par Total. La procédure de sélection était rude, et le processus intense, en particulier parce qu’il survenait dans un contexte politique tendu. En 2011, toutes les principales institutions du pays ont fermé sous l’effet d’un soulèvement populaire. Alors Total a dû nous envoyer au Caire pour passer l’examen GMAT. J’ai pris mon vol de retour et les aéroports ont fermé le lendemain. Mais j’ai réussi l’examen et on m’a proposé une place !
Pour être honnête, la France n’était pas mon premier choix, parce que je ne parlais pas la langue, je n’y avais aucune connaissance et j’avais entendu dire que le principe de laïcité en France marginalisait les musulmanes. Mais je savais que c’était une opportunité unique. J’ai annoncé la nouvelle à ma famille, qui ne savait même pas que j’avais candidaté. Comme je m’y attendais, les objections ont commencé à pleuvoir : « Comment vas-tu voyager ? Tu as besoin d’être accompagnée par un homme ! Tu ne seras pas la bienvenue là-bas ! » Ma mère était inquiète, mais sa fierté a pris le dessus et elle m’a laissée partir.
Vous dites que votre expérience à Audencia vous a changé la vie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
En arrivant à Nantes, je me suis retrouvée toute seule, ce qui ne m’était pas arrivé depuis une éternité. Il n’a pas été facile de trouver une tenue appropriée. Au Yémen, je portais l’abaya, un vêtement long qui ne laissait que les yeux apparents. Je savais que je devais trouver un compromis entre un look moderne acceptable en Occident et une apparence modeste avec laquelle je me sentirais à l’aise. J’avais décidé que si on me demandait une seule fois de retirer mon hijab, je reprendrais l’avion dans l’autre sens. Heureusement, dans les institutions privées, les règles relatives aux vêtements religieux sont plus souples que dans les universités publiques. Pour autant, j’ai dû fournir un effort monumental pour montrer mon visage ; les premiers mois, je me suis sentie mise à nue.
Au début, certaines normes sociales m’ont inquiétée, par exemple le serrage de mains. Ensuite, en observant mes camarades japonais s’incliner, j’ai trouvé réconfortant de réaliser que j’étais loin d’être la seule à avoir des habitudes culturelles différentes. Un jour au début de l’année, nous plaisantions ensemble en classe et une Asiatique m’a confié qu’elle n’aurait jamais pensé qu’une musulmane pouvait rire et être amicale ! Je me suis d’abord sentie choquée et un peu insultée, mais nous avons fini par nouer une très belle amitié et des années plus tard, j’ai même séjourné chez elle, aux États-Unis. Notre classe de MBA était véritablement internationale et le personnel d’Audencia faisait toujours attention aux considérations culturelles, ce qui m’a progressivement aidée à me sentir moins maladroite. Nous sommes tous devenus une deuxième famille les uns pour les autres, nous avons formé un réseau social et nous avons tous appris à mieux nous comprendre culturellement.
Oui, mes années à Audencia m’ont littéralement changé la vie. J’ai pris confiance en moi et j’ai appris à y voir plus clair dans mes aspirations professionnelles. J’ai également abandonné les préjugés que je pouvais avoir sur la culture occidentale. J’ai compris que je devais arrêter d’appréhender le monde par le prisme de ma communauté, ou des médias, et que je devais commencer d’appliquer mes propres filtres.
Quels sont vos meilleurs souvenirs de vos études à l’École ?
Sur le plan académique, je me suis attachée à allier mes intérêts pour l’autonomisation communautaire et le développement social avec mes nouvelles compétences en gestion des entreprises. J’ai découvert le concept de responsabilité sociale des entreprises et j’ai basé mon projet de fin d’études dessus.
Pendant les vacances scolaires, j’ai passé d’excellents moments avec mes camarades de promo lors d’escapades en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. Nos modalités de déplacement étaient radicalement différentes de la manière de faire dans les pays arabes, centrée sur le confort et la sécurité. J’ai expérimenté tellement de « premières fois » lors de ces voyages : Apprendre à me servir d’une carte papier ! Voyager en train ! Dormir dans un sac de couchage ! Sur le plan alimentaire, je suis devenue de plus en plus audacieuse : j’ai essayé les sushis et je le confesse… même les escargots !
Vous avez occupé des fonctions prestigieuses au Yémen. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Mon retour au Yémen a coïncidé avec la conclusion d’un accord pour que la Conférence du dialogue national entre dans une phase pacifique afin de préparer une nouvelle constitution. À ce moment-là, je m’étais fait un nom dans le secteur des activités à but non lucratif et j’avais un MBA d’une école de commerce respectée. Rapidement, on m’a confié la charge de diriger l’Unité de participation communautaire au Secrétariat général de la conférence historique qui s’est tenue entre 2013 et 2014. Pour faire simple, j’étais tenue de m’exprimer au nom de ceux qui n’ont pas voix au chapitre dans notre société, afin de promouvoir le dialogue : les femmes, les jeunes et les ONG. C’était la fonction la plus haut placée que je n’avais jamais occupée. Les travaux du Secrétariat général étaient directement communiqués au Président du Yémen, et je traitais avec les dirigeants politiques, ainsi qu’avec l’Envoyé spécial des Nations Unies. C’était également le poste le plus gratifiant, car c’était une opportunité de contribuer au nouveau Yémen.
Après cela, les Nations Unies m’ont embauchée pour gérer une plateforme de communication qu’elles avaient établie pour donner les moyens aux groupes indépendants de communiquer, ce qui fut un autre poste très gratifiant. Tragiquement, des conflits ont éclaté, qui ont sonné le glas de la transition pacifique. À la fin de la journée, les choses étaient hors de contrôle.
Pouvez-vous nous parler des conditions dans lesquelles vous avez dû fuir votre pays ?
En 2015, les bombardements se sont intensifiés et le conflit s’est transformé en guerre traumatisante et sans merci. J’étais déterminée à sortir ma famille du pays. Les Nations Unies m’avaient invitée à participer à une conférence de paix à Genève, mais personne en dehors du personnel de l’ONU n’était autorisé à monter dans leurs avions. Je ne me voyais pas partir en laissant ma famille derrière moi, et comme la coalition saoudienne avait bombardé tous les aéroports, je me suis résignée à organiser un voyage risqué en bus jusqu’à Oman pour ma mère, mes frères et sœurs et moi. De là, nous avons pris un avion pour la Malaisie, un pays dont l’islam est la religion officielle et où je pensais que nous serions en sécurité.
Nous avons fini par attendre six mois très frustrants, avec très peu de visibilité sur l’évolution de la situation, voire aucune, et nos économies fondaient comme neige au soleil. Après avoir occupé une fonction onusienne de premier plan avec des perspectives attrayantes, je me retrouvais bloquée en exil.
Un jour, cependant, j’ai reçu une nouvelle inattendue. J’avais été acceptée à un mastère en développement international aux États-Unis pour lequel j’avais déposé un dossier l’année précédente. La bourse avait été accordée à quatre candidats seulement et j’étais la seule femme ! J’étais abasourdie, mais j’étais également mitigée en raison de la situation politique instable au pays. En définitive, ma mère m’a persuadée d’y aller. Elle m’a rappelé que j’avais travaillé dur pour décrocher cette bourse. Elle m’a dit : « L’ONU a mis un terme à ton contrat, alors tu n’as aucune raison de rentrer à la maison. Tu aides la famille depuis la mort de ton père et tes frères et sœurs sont presque tous arrivés à l’âge adulte. Il est temps de penser à ton propre avenir. Ne rate pas cette chance. » C’était la première fois que ma mère me donnait son avis aussi ouvertement.
Je me suis envolée pour les États-Unis afin de poursuivre mon éducation comme j’en rêvais, rongée par la culpabilité, car ma famille retournait au Yémen où elle serait en danger. Aujourd’hui encore, il m’arrive souvent de regretter ma décision, car à cause de ça, je n’ai plus vu ma famille pendant cinq ans.
Parlez-nous de votre expérience d’être une femme yéménite aux États-Unis sous l’administration Trump.
Mon plan était de terminer mon mastère à l’université de l’Ohio, puis de rentrer au Yémen en meilleure posture pour contribuer à la reconstruction de mon pays. Mais la guerre n’était toujours pas terminée ; elle fait rage aujourd’hui encore. Il y a eu des moments où j’ai voulu désespérément rentrer à la maison, en particulier quand mon grand-père est tombé malade. Cependant, ma famille a toujours catégoriquement refusé de me laisser rentrer, arguant que des millions de Yéménites sont bloqués en enfer et que je ne devais pas compromettre ma propre sécurité. Au lieu de cela, j’ai essayé de trouver des moyens de me rendre utile en travaillant et en me portant volontaire à l’université pour aider les étudiants internationaux à s’adapter à la vie locale et à la culture étasunienne.
Par la suite, la nouvelle administration a imposé des restrictions aux citoyens yéménites. Si je sortais du territoire, je risquais de ne plus être autorisée à y entrer et donc, de perdre ma bourse. Une opportunité d’emploi m’est passée sous le nez à cause de ma nationalité : le recruteur a craint que l’interdiction pesant sur les Yéménites complique trop les procédures de recrutement. Pourtant, le projet consistait à aider les communautés yéménites… et ils ont recruté une personne égyptienne ! Pour moi, toute cette situation était à la fois précaire et de mauvais augure. Après tant de sacrifices, je me suis sentie indésirable et stigmatisée. J’ai sombré dans la dépression et j’ai su que je devais partir.
Comment en êtes-vous venue à commencer une nouvelle vie au Canada ?
J’y avais de la famille. De plus, le pays a une politique favorable à l’accueil des Yéménites, auxquels il reconnaît le statut de victimes de guerre, comme il le fait pour les Syriens. Je n’avais jamais envisagé de m’installer au Canada, mais la vie ne se déroule pas toujours comme on s’y attend. Je devais juste accepter mon sort et apprendre à vivre avec les conséquences de mes choix. En 2013, je pensais que je me trouvais dans une excellente situation, entourée de mes proches, avec de bonnes qualifications, un travail de rêve et un réseau. J’ai dû recommencer à zéro dans une nouvelle communauté.
Aujourd’hui, je travaille comme agent de liaison multiculturel, j’aide les réfugiés et les migrants professionnels à s’installer et à s’intégrer. J’évalue leurs besoins, je les oriente vers des ressources appropriées, je les aide avec les traductions et je les informe des différences culturelles. Ce travail me rend heureuse. Je peux de nouveau ressentir ce sentiment gratifiant de faire une différence. Je me suis progressivement constitué un nouveau réseau social, je sors, j’essaie de nouveaux sports, je voyage… dans tout le Canada.
Quel est votre souhait le plus cher pour demain ?
Dans l’immédiat, mon objectif est de faire venir ma mère et mes frères et sœurs au Canada, qui est devenu ma deuxième maison. À long terme, mon plan est d’aider les Yéménites et de revenir visiter le Yémen un jour. Je sais que ça prendra des années, parce qu’il n’y a pas de solution en vue pour mettre fin au conflit. C’est devenu une question géopolitique extrêmement compliquée qui constitue actuellement la crise humanitaire la plus grave au monde. Mon frère le plus jeune a douze ans et lui aussi, comme tous les autres Yéménites, mérite mieux. Ma vie ne vaut pas plus que celle des gens au Yémen, mais je refuse de devenir un numéro de plus ajouté à la liste des victimes.
Mon souhait, c’est de laisser mon empreinte dans le monde, où que je sois. Mon but, c’est d’aider les moins privilégiés à vivre décemment, comme c’est leur droit.
Comment vous y prenez-vous au quotidien pour surmonter le désespoir et la frustration ?
Mon travail m’apporte un but et un certain confort. Je reste en contact avec ma famille et nous nous remontons le moral mutuellement. Ma philosophie, c’est que rien ne dure éternellement, que ce soit le bonheur, la tristesse ou les difficultés. Je crois au karma et que des jours meilleurs adviendront. J’essaie également de regarder en arrière et d’apprécier les progrès que j’ai accomplis : je suis arrivée dans ce pays en me sentant comme une victime qui n’avait pas de plan et aucun contrôle sur sa destinée. Maintenant, j’ai une carrière, de nouveaux amis et de plus, je me suis autorisée à rêver de nouveau.
Quels sont vos plans pour le week-end ?
Nous avons un week-end prolongé au Canada pour Thanksgiving. Après cette entrevue avec vous, je vais enchaîner directement avec un appel sur Skype avec un de mes anciens collègues au Yémen. J’adore prendre des nouvelles et c’est important pour moi de garder le contact avec mon réseau au pays. Ensuite, je vais aller faire une longue balade au parc pour m’imprégner des magnifiques couleurs de l’automne canadien. Je n’ai jamais rien vu de tel !