Victoria Mandefield
![]() Reading Time: 9 minutes
Reading Time: 9 minutes
Fondatrice & CEO Solinum
Victoria Mandefield est une entrepreneuse sociale et la fondatrice et PDG de Solinum, créatrice de Soliguide, un guide de survie et de soutien pour les sans-abri. Elle est désormais reconnue en France comme un acteur clé de la sensibilisation et de la recherche de solutions pour les sans-abri.
Elle continue de bousculer le monde de l’impact sociétal en travaillant en étroite collaboration avec les grands systèmes d’aide français, dont le 115, le centre d’appel des services sociaux d’urgence, ainsi que la Croix-Rouge française.
Pressée, décidée, sans artifice superflu, Victoria Mandefield vit à cent à l’heure. Du haut de ses 28 ans et bien ancrée dans un quotidien engagé, elle ne s’embarrasse pas de détours ou de routes qui rallongent. À nos questions qui lui servent de pause déjeuner, assise sur deux cartons de déménagement, elle répond, la voix enrouée par un virus tenace, par des mots simples, précis et directs.
Le temps est une ressource précieuse qu’elle ne dilapide pas et court, sautant les étapes inutiles, délaissant les questions sans réponse, concentrée sur l’action, l’engagement et la maximisation de son impact sur les hommes et le monde qui l’entourent.
Racontez-nous votre parcours.
Je suis entrée à Audencia en 2017, dans le cadre d’un double diplôme ingénieur-manager en partenariat avec l’ECE Paris. J’avais déjà un projet entrepreneurial dans le domaine social pour lequel j’avais acquis des compétences techniques, mais il me manquait un business plan. Alors j’ai rejoint Audencia, que je percevais comme l’école de l’audace et la responsabilité sociale.
À Audencia, l’hybridation technique – business est une marque de fabrique, j’en suis d’ailleurs un pur produit. Mais je crois aussi à l’hybridation entre l’audace et l’impact et c’est ce que je recherchais avant tout.
J’ai démarré mon parcours par une grosse période de rattrapage, en compta notamment (merci, car je m’en sers tous les jours). Puis, j’ai enchaîné sur une Summer School à Berkeley, une expérience incroyable à plein d’égards. J’ai suivi des cours à la carte, en leadership, en innovation bien sûr et puis en comptabilité avancée. J’ai vécu trois mois d’une expérience humaine très forte et j’ai beaucoup appris, d’autant que Berkeley est vraiment très avancé en innovation durable et en entrepreneuriat social.
Quand je suis rentrée, j’ai donc très naturellement basculé sur le master Entrepreneuriat d’Audencia avec l’option Economie Sociale et Solidaire. J’ai eu la chance de pouvoir suivre ce parcours en appliquant immédiatement mes apprentissages académiques à mon projet personnel, Solinum. Une forme d’apprentissage par l’expérimentation et l’immersion, très puissante et passionnante. C’est le véritable plus de ce programme. En revanche, côté agenda, c’était compliqué, car Solinum commençait à décoller et j’avais de nombreux rendez-vous : je faisais très, très souvent l’aller-retour entre Nantes et Paris.
Justement, Solinum, vous pouvez nous en parler ?
Solinum, c’est une start-up sociale qui vient d’un double constat : d’une part, contrairement à ce que l’on croit, plus de 70% des personnes vivant des situations de précarité ont accès à un smartphone et d’autre part, le numérique n’est pas un facteur de déshumanisation. Au contraire !
Le numérique peut se mettre au service de l’inclusion et de l’humain, si on s’en sert à bon escient.
Depuis que je travaille dans le secteur de la solidarité, je suis marquée par la lenteur de la transformation digitale. Quelques multinationales disposent de moyens colossaux pour gagner un minuscule point de marge mais les associations au service de l’humain, elles, fonctionnent encore au papier, crayon.
Alors, quand on me demande ce qui caractérise le plus Solinum, tech ou engagement, ma réponse est claire : les deux sont indissociables. La tech doit venir au service de l’engagement.
Loin de l’image d’une jeune ingénieure aux tendances geek, alors…
Si geekette veut dire amatrice de jeux vidéo, alors oui, j’en suis une, d’une certaine façon.
Je suis surtout passionnée par l’automatisation. J’adore prototyper. En réalité, je déteste reproduire deux fois la même chose : si on a besoin de refaire quelque chose, c’est qu’il y a un truc à créer pour gagner du temps et maximiser le rapport entre l’effort produit et l’impact obtenu.
Dans le domaine de la solidarité, c’est un concept très important parce que c’est là que la tech replace l’humain au cœur du sujet. Quand on gagne du temps et de la fiabilité sur des actions à faible valeur ajoutée, on peut se concentrer sur l’essentiel : l’humain, l’interaction, la rencontre.
En revanche, je crois aussi que l’innovation peut être très sobre. C’est un peu paradoxal pour une ingénieure, mais je ne suis pas une fervente défenseure de l’innovation pour l’innovation. Les meilleurs outils sont parfois les plus simples, surtout s’ils sont efficaces, qu’ils répondent au besoin des utilisateurs. C’est ça l’essentiel dans la tech : répondre au besoin des utilisateurs, qu’ils soient multimillionnaires ou en situation de grande précarité.

Mais pourquoi avoir choisi cette voie de la précarité plutôt qu’une autre ?
Je suis bénévole depuis très longtemps. Depuis que je suis étudiante, je fais des maraudes pour distribuer des repas, des vêtements chauds et pour apporter du soutien aux personnes sans abri. Avec Soliguide, qui est une plateforme permettant d’orienter les personnes en situation de grande précarité vers les services dont elles ont besoin, j’ai créé l’outil dont j’avais besoin en tant que bénévole.
Le point de départ de Soliguide, c’est d’ailleurs ce besoin concret. Pour orienter les publics, les bénévoles compilent toutes les informations utiles dans le domaine de l’aide alimentaire, du suivi socio-professionnel, de l’hygiène, de la santé, de la formation, de l’apprentissage du français, etc. Ensuite, il faut tout vérifier : Est-ce que telle structure est bien ouverte à l’instant T ? Est-ce qu’ils n’ont pas changé les horaires d’accueil ? Est-ce que telle aide est toujours disponible ? Etc.
Au-delà de la collecte de la donnée, de son regroupement avec d’autres données similaires, il y avait donc la question de la fiabilisation et de la mise à disposition de manière simple et pratique pour tous les utilisateurs, particuliers ou associatifs.
C’est comme ça qu’est né Soliguide. Ce n’est pas une invention incroyable : c’est juste un outil, simple, dépouillé, mais extrêmement puissant car elle est conçue pour être partagée. Pour y accéder, on a multiplié les biais avec un site, une app, des listes papiers, un numéro Whatsapp, … On a même créé l’API Solidarité pour permettre à d’autres organisations de récupérer nos données et de les utiliser pour délivrer leurs propres solutions d’accompagnement. Par exemple, l’association Entourage qui créé des liens et de l’animation locale pour les personnes exclues ou isolées travaille avec nos données : nous ne le vivons pas du tout comme une compétition mais comme une coopération essentielle au service des personnes en situation de précarité.
Comment ça fonctionne, concrètement, Soliguide ?
Notre travail consiste essentiellement à collecter, croiser, fiabiliser et délivrer des données. Soliguide compte aujourd’hui près de 50 000 services référencés pour des personnes rencontrant une difficulté dans 29 départements. Je suis très fière de dire que nous couvrons aujourd’hui plus de 50 % de la population française. En 2022, Soliguide a permis plus d’1,5 million de recherches : notre impact se compte désormais en centaines de milliers de vies.
Solinum a accueilli son premier salarié en 2018 et, aujourd’hui, nous sommes 32 pour lever des fonds, déployer nos projets, diffuser nos actions auprès des acteurs de la solidarité. Surtout, co-construire avec eux, car les projets ne se calquent pas d’un territoire à l’autre, ils s’adaptent aux réalités locales.
Nous sommes subventionnés par les collectivités et l’État, notamment car on facilite le travail et on augmente l’impact des acteurs sociaux. On a découvert qu’on fait faire des économies à la société et qu’on améliore l’efficacité des politiques publiques : on évite les doublons comme les trous dans la raquette, on rationnalise les décisions publiques. C’est apparu très clairement pendant la pandémie.
Quel impact a eu la crise sanitaire sur l’activité de Solinum ?
Nous avons été extrêmement sollicités sur les départements où nous étions présents, et le mot a très vite circulé avec des territoires qui nous ont demandé de nous déployer dans l’urgence. Ce n’était pas toujours possible, mais nous avons fait au mieux.
Imaginez la signification particulière du confinement pour des personnes à la rue : quelles structures fonctionnent, lesquelles sont fermées, où peut-on trouver à manger, etc. ? Les infos sur Soliguide nous ont permis d’alerter, quand par exemple tous les services d’une zone étaient fermés.
Au début de la pandémie, nous ne couvrions que sept départements et nous avons constaté une surutilisation de +200%. En 2021, grâce à une méthodologie de déploiement extrêmement carrée, nous avons donc ouvert quinze nouveaux départements, ce qui nous a préparés à vivre la crise ukrainienne à laquelle nous avons immédiatement réagi en traduisant Soliguide en ukrainien ou en identifiant les structures spécifiques les plus nécessaires aux réfugiés venus d’Ukraine.
Toutes ces crises successives mettent en lumière l’importance de l’information en temps réel pour les personnes comme pour les pouvoirs publics. Ce vers quoi on se tourne aujourd’hui, c’est l’utilisation de l’analyse de données au service des politiques sociales dans chaque territoire.
Vous évoquez le financement de Solinum. On imagine mal le secteur de la solidarité comme une terre d’ambition pour une jeune diplômée d’école de management.
On ne va pas se mentir, mes parents auraient sans doute préféré me voir suivre une filière plus rémunératrice. Mais je suis en phase avec ce que, moi, j’attends de la vie. Si je gagnais plus en faisant autre chose, serais-je aussi heureuse ? Je ne crois pas.
Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas avoir un salaire en travaillant dans un secteur engagé, les curseurs sont d’ailleurs en train de bouger là-dessus, mais évidemment on gagne moins que dans une grande boite qui détruit la planète.
Je gagne ce qu’il me faut pour combler mes besoins : j’ai ce qu’il faut pour satisfaire mes besoins matériels tout en conservant la possibilité de combler mes besoins immatériels, le sens, le goût de me lever le matin. La seule ressource absolue que l’on a, c’est le temps, mais est-ce qu’on l’utilise à bon escient ? Je ne veux pas d’une vie où je démarre la semaine en pensant : « Vivement vendredi ! » « Vivement que je sois quelque part, ailleurs qu’à mon travail ! »
Mon ratio, c’est : gagner suffisamment pour m’offrir ce qui m’est nécessaire sans dilapider ma ressource temps au détriment de la planète, de la société et de moi-même. La différence de salaire, c’est donc le prix de mon équilibre personnel.
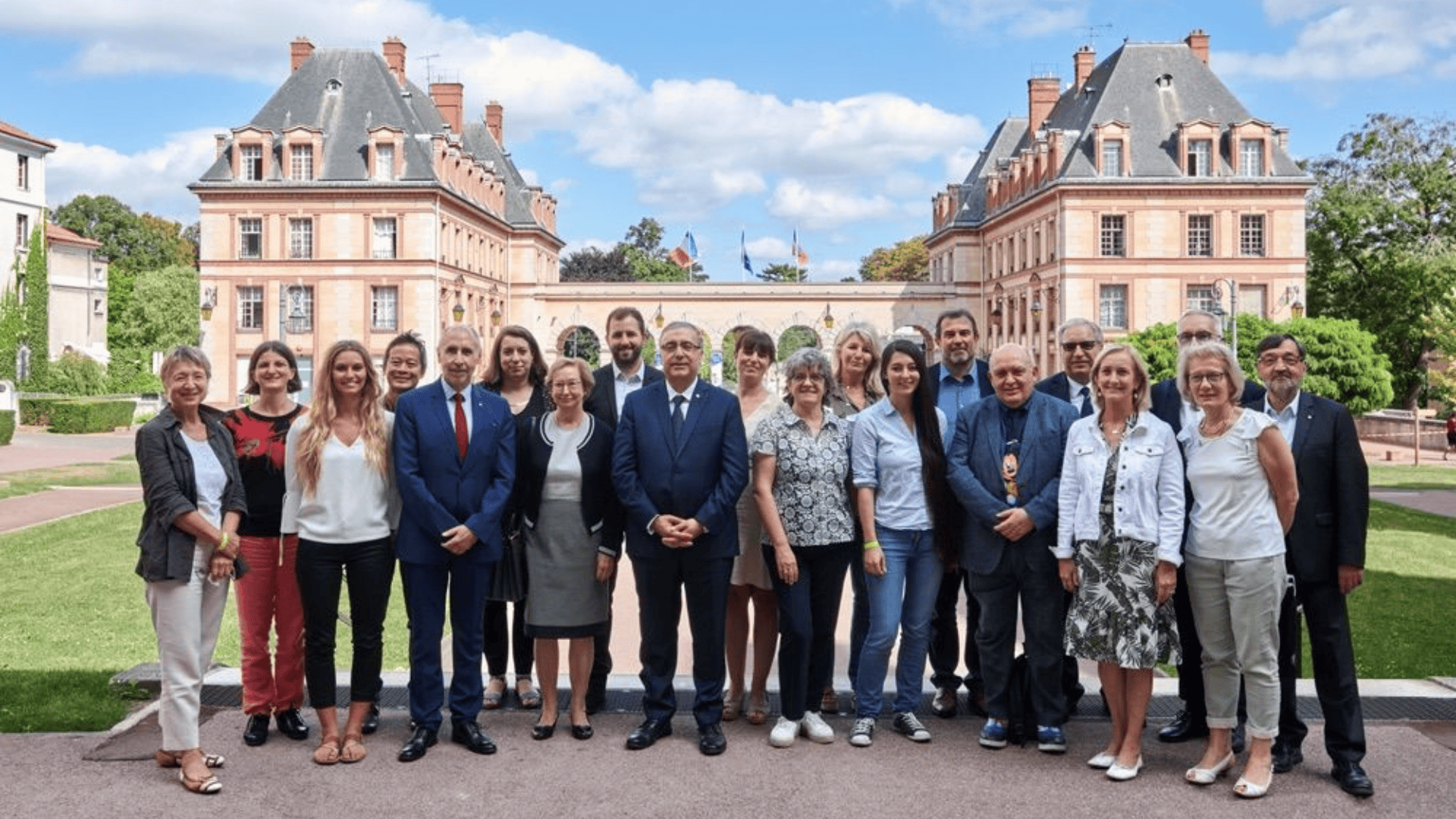
Être une femme dirigeante, dans le secteur de la solidarité, comment ça se passe ?
Une jeune femme, en plus, je cherche un peu la m***Il m’est arrivé plus d’une fois qu’on me demande si je suis la stagiaire. Au-delà de l’anecdote qui ne me blesse pas plus que ça, il est clair que l’enjeu de crédibilité est fort. Comme dans tous les milieux, les regards se tournent d’abord vers les hommes, même dans ce secteur, où sur le terrain, il n’y a que des femmes. On ne dit que « assistante sociale », d’ailleurs, au féminin. On est dans un secteur fait par des femmes, mais comme souvent dirigé par des hommes qui sont omniprésents dans les tables rondes et les conseils d’administration. Moi, j’essaie de faire mon chemin, de faire tout court. C’est l’action qui donne la crédibilité. Je ne m’offusque pas de ce que les gens pensent, j’avance et je construis mon chemin. D’autant plus qu’il y a une véritable urgence à regarder la diversité sous un autre angle, y compris dans le secteur de la rue qui est beaucoup plus contrasté que ce que les gens imaginent. On ne parle pas seulement d’hommes à la dérive, on parle aussi de jeunes LGBTQ+ rejetés par leur entourage, de femmes qui se cachent pour fuir des violences conjugales, de familles entières paupérisées par les migrations ou des ruptures sociales. Cette image de la rue comme un milieu d’hommes a toujours été un peu fausse, mais elle l’est de plus en plus, et la pandémie n’a rien arrangé. Aujourd’hui, dans les soupes populaires, on voit de plus en plus d’étudiants qui tenaient grâce à des jobs d’été qu’ils n’ont pas eu après le stop pandémique. Le sujet, ce n’est pas moi ou le regard que les gens portent sur les femmes dirigeantes, le sujet, c’est comment on travaille mieux tous ensemble, comment on multiplie les angles de vue pour mieux cerner et traiter les problématiques.
Vous êtes aussi administratrice de la Croix-Rouge, en quoi ça consiste ?
J’y suis entrée en passant par 21, l’accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge. Solinum a été accompagné pendant six mois dans le cadre d’un appel à projets, et je suis tombée amoureuse de cette organisation. C’est comme ça que j’ai fini au conseil d’administration 2 ans plus tard.La Croix-Rouge, c’est une très grosse machine, qui peut paraître lente et lourde pour un entrepreneur, mais quand elle bouge, elle bouge fort. Dans l’urgence, on sait être là où l’on nous attend. On est au rendez-vous.Depuis un peu plus d’un an, donc, je suis au CA. C’est un poste bénévole qui me mobilise deux jours tous les trois mois, en plus des commissions de travail. Nous étudions tous les dossiers d’orientation juridique et stratégique de la Croix-Rouge pour coller au plan 2030.Les bénévoles ont des profils variés, souvent avec de belles expériences, et je suis heureuse de représenter en partie la jeunesse. La diversité des points de vue enrichit le débat, par exemple sur les enjeux d’écologie.
Si vous deviez donner un conseil aux étudiants d’aujourd’hui, ce serait autour de l’engagement ?
Non, l’engagement, c’est mon truc à moi, mais ce n’est pas nécessairement celui de tout le monde. Je leur dirais de trouver ce qui les fait vibrer et d’y aller à fond. Je leur dirais surtout que tout est hyper légitime, même ce qui ne semble pas faire partie de la voie toute tracée.
Et pour la suite, que peut-on vous souhaiter ?
Pour Solinum ? De continuer son développement. Je ne veux surtout pas que l’on devienne une grosse organisation, mais je veux qu’on augmente encore notre impact. La courbe doit être exponentielle. On doit toucher toujours plus de monde en France et même ailleurs en Europe, sans pour autant décupler nos charges.
Et pour moi ? De finaliser mon déménagement. Pas si loin des 30 ans, je quitte enfin mon 20 m² en sous-sol. Comme quoi, tout arrive.
Victoria Mandefield (GE 18), 28 ans, dirige Solinum, une start-up sociale qu’elle a créée en 2016 et qui édite les plateformes Soliguide et Merci pour l’Invit’, un réseau d’hébergement citoyen vers la réinsertion. Administratrice de la Croix-Rouge (2021), Victoria fait partie des 30 under 30 de Vanity Fair et du Top 50 des entrepreneurs à impact de Carenews. Son action et son engagement ont été récompensés par plusieurs trophées, en particulier comme AACSB Influential Leader, class of 2023.

